En tant que premier archétype transformationnel du cycle des « arcs de vie », l’arc de la jeune fille est l’histoire par excellence du passage à l’âge adulte. C’est l’histoire de l’angoisse adolescente, des joies et des peines de grandir, et de la lutte pour devenir un être humain pleinement autonome et mature.
Comme tous les arcs, celui de la jeune fille ne se produit pas par hasard. Et (malgré son impatience d’avoir seize ans et d’avoir sa première voiture) elle ne le choisit pas nécessairement. Bien que les humains puissent se préparer aux arcs de transformation, nous ne pouvons pas les initier nous-mêmes. Les circonstances extérieures de notre environnement social et notre propre progression chronologique dans la vie sont des facteurs majeurs qui finissent par créer les forces nécessaires pour déclencher un arc de changement. Ces circonstances peuvent être considérées, à bien des égards, comme la force antagoniste qui définit à la fois l’intrigue et le thème d’un arc de vie.
Pour l’arc de la jeune fille, cette force antagoniste peut être considérée de manière archétypale comme les figures d’autorité qui initient sa transition de l’enfance vers les débuts d’un arc héroïque. Mais dans son conflit intérieur (et parfois extériorisé dans l’intrigue extérieure), nous pouvons également voir qu’elle est confrontée à un prédateur effrayant, un gardien redoutable qui semble l’empêcher de franchir les portes de l’âge adulte.
Les antagonistes de la jeune fille : aspects pratiques et thématiques
Comme mentionné dans l’introduction de la semaine dernière, il existe en réalité plusieurs antagonistes symboliques qui peuvent être considérés comme importants dans les arcs narratifs archétypaux. En particulier, on peut généralement en identifier deux : l’un qui représente le conflit extérieur du protagoniste et l’autre qui symbolise principalement le conflit intérieur. Lequel est lequel dépendra en grande partie des facteurs uniques de votre histoire particulière.
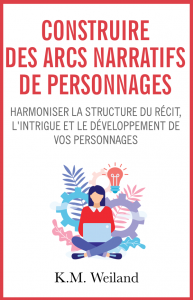
Disponible sur Amazon et en librairie
Pour la jeune fille, ces deux antagonistes sont les figures d’autorité et le prédateur.
L’autorité en tant qu’antagoniste archétypal
Réussir son entrée dans l’âge adulte ne se résume pas à passer par la puberté ou à avoir seize ou vingt et un ans. À un niveau plus profond, il s’agit d’une initiation de l’âme, d’une transition profonde de l’innocence et de la dépendance de l’enfance à la complexité et à la responsabilité de l’âge adulte. Cette initiation est, de manière quelque peu paradoxale, guidée par les figures d’autorité dans la vie de la jeune fille.
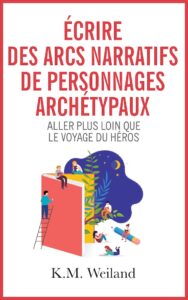
Le paradoxe réside dans le fait que ces figures d’autorité veulent que la jeune fille suive son arc et grandisse. Les figures d’autorité sont inévitablement celles qui encouragent et même exigent cette transition. Et pourtant, les figures d’autorité sont aussi celles contre lesquelles la jeune fille doit lutter pour « s’échapper ».
Il est toujours possible de représenter ces deux facettes de l’autorité dans des personnages différents : l’autorité encourageante et initiatrice peut être incarnée par un parent ou un aîné sage, tandis que l’aspect négatif de l’autorité égoïste ou étouffante peut être
Cependant, je pense que la plupart d’entre nous peuvent reconnaître que ces deux aspects cohabitent généralement chez une même personne. Les parents qui aiment leurs enfants souhaitent les voir devenir des adultes responsables, même si une partie d’eux-mêmes souhaite garder l’enfant sous leur garde et leur contrôle.
Il est donc important de reconnaître que, bien que l’Autorité soit l’antagoniste archétypal dans l’arc de la jeune fille, elle ne s’oppose pas nécessairement à elle pour des raisons maléfiques ou même purement égoïstes.
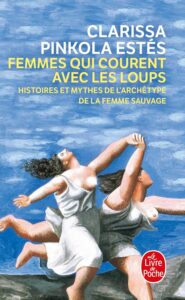
Dans l’article sur l’arc de la jeune fille, j’ai mentionné que cette autorité pouvait être caractérisée soit comme le père naïf, soit comme ce que Clarissa Pinkola Estés appelle la « mère trop bonne ». Ces titres signifient que les parents en sont venus à représenter, dans le processus de maturation de la jeune fille, une stagnation et/ou l’achèvement de leur capacité à l’éduquer. Même les meilleurs parents du monde finiront par épuiser ce qu’ils peuvent transmettre à leurs enfants ; à un certain moment, la jeune fille doit toujours se lancer pour apprendre par elle-même.
Bien sûr, cette autorité peut également être représentée par d’autres facettes de la société, telles que les enseignants, les chefs religieux ou les personnalités politiques. Elle peut être représentée de manière abstraite par une « institution » ou le « système ». Elle peut même être simplement intériorisée dans la conscience évolutive de la jeune fille. La voix autoritaire la plus forte, qui tente de la convaincre de rester dans l’ignorance et l’irresponsabilité, peut être celle qui résonne dans sa tête, lui disant qu’elle ne sait pas ce qu’elle fait, qu’elle devrait simplement faire confiance à ceux qui savent mieux qu’elle, qu’elle ferait mieux de faire ce qu’on lui dit. En effet, cet état d’esprit peut être l’antagoniste le plus redoutable auquel toute jeune fille est confrontée et, s’il n’est pas surmonté, il peut faire en sorte qu’une personne reste longtemps soumise à l’Autorité.
Le Prédateur en tant qu’antagoniste archétypal
L’Autorité est l’antagoniste archétypal le plus évident auquel toute jeune fille doit faire face. Mais il existe une autre force opposée importante dans son parcours : le Prédateur.
Classiquement, le prédateur est mieux représenté dans des contes tels que « Les sept femmes de Barbe-Bleue » et « La fille sans mains ». Ces deux histoires mettent en scène une force masculine prédatrice qui souhaite épouser la jeune fille. Dans la première, il s’agit du personnage principal, Barbe-Bleue, qui a notoirement assassiné toutes ses précédentes épouses et conservé leurs corps enfermés dans une pièce secrète. Dans le second, c’est le Diable qui coupe les mains de la jeune fille lorsqu’elle le repousse.
Symboliquement, le Prédateur représente une présence masculine séduisante mais toxique. La jeune fille, à l’aube de son éveil sexuel et d’un monde nouveau qu’elle ne comprend pas encore, manque au départ de la sagesse nécessaire pour faire la distinction entre ce Prédateur toxique et le masculin digne représenté par le Protecteur.
Bien qu’il soit souvent caractérisé par un intérêt amoureux, l’implication du Prédateur auprès de la Jeune fille n’est pas nécessairement romantique ou sexuelle. Il représente fondamentalement les dangers séduisants du monde étrange et excitant « là-bas ». Mais au début, la jeune fille ne reconnaîtra pas que le prédateur est, en substance, une extension du côté obscur de cette même autorité contre laquelle elle lutte pour s’individualiser. Si elle tombe sous l’emprise de cet aspect contrôlant de la masculinité, elle n’obtiendra pas l’indépendance qu’elle recherchait en « l’épousant », mais se retrouvera au contraire plus profondément enracinée que jamais dans les structures autoritaires mêmes qu’elle cherchait à dépasser.
Il est possible que des figures d’autorité sages (dont la jeune fille doit néanmoins encore s’individualiser) reconnaissent la menace que représente le prédateur et lui donnent des conseils (au moins partiellement ignorés) contre son implication avec lui. Mais comme dans les contes populaires mentionnés ci-dessus, il est habituel que les figures d’autorité s’associent au plan du prédateur pour prendre la jeune fille pour épouse. Cela peut provenir d’un désir égoïste de maintenir la jeune fille sous leur contrôle ou à leur avantage (comme la mère de Rose dans Titanic, une femme qui s’est explicitement opposée à l’individualisation de sa fille en exigeant qu’elle épouse un homme riche mais brutal), ou bien le « père naïf » et la « mère trop bonne » (comme dans l’histoire de « La fille sans mains » et dans tant d’autres contes de fées sur les bébés maudits) soient simplement trop stupides ou asservis pour reconnaître ou s’opposer à la proposition du prédateur à leur fille.

Cependant, il est également important de reconnaître que le Prédateur est en fin de compte représentatif d’un aspect psychique de la Jeune Fille elle-même alors qu’elle entreprend ce voyage. Le Prédateur est la « voix intérieure critique », la voix dans sa jeune tête qui lui dit qu’elle n’est pas assez bonne, assez intelligente, assez courageuse pour déjouer les ruses du Diable et traverser seule le Désert.
Dans de nombreuses histoires, le prédateur peut être le plus représentatif de la lutte intérieure de la protagoniste contre ses propres insécurités et ses propres peurs. Après tout, grandir est une entreprise effrayante, et souvent, les parties sombres et dominantes de nous-mêmes sont nos adversaires les plus redoutables.
Comment les antagonistes archétypaux de la jeune fille agissent dans le conflit et le moment culminant
Le rôle le plus fondamental de l’antagoniste est de générer le conflit de l’intrigue. Pour ce faire, l’antagoniste crée constamment des oppositions ou des obstacles qui empêchent le protagoniste d’atteindre l’objectif de l’intrigue. Ces obstacles obligent le protagoniste à reconsidérer son mode de vie, ses croyances et ses tactiques. L’opposition de l’antagoniste le force à évoluer, ce qui permet de créer une histoire extériorisée qui entraîne également une transformation personnelle chez le protagoniste.
Dans l’arc narratif de la jeune fille, l’objectif de l’intrigue du protagoniste peut être multiple (obtenir son diplôme d’études secondaires, trouver un emploi, fuguer, rester à la maison, attirer l’attention d’un être cher, acquérir une nouvelle compétence, survivre à une catastrophe, etc. ). Mais l’objectif thématique sera toujours celui de grandir, d’acquérir une certaine indépendance, autonomie et responsabilité personnelle.
Cela signifie que les antagonistes archétypaux d’un arc narratif de la jeune fille s’opposent toujours fondamentalement, d’une manière ou d’une autre, à son passage à l’âge adulte. Il est possible qu’ils soient finalement favorables à sa maturation (après tout, quel parent ne souhaite pas que son enfant obtienne son diplôme d’études secondaires ?), mais pas à la manière dont la jeune fille s’y prend (par exemple, elle souhaite peut-être aller dans une université différente de celle où ses parents ont étudié).
Ce qui importe, c’est que la protagoniste souhaite quelque chose qui représente ou permette son individuation et son initiation à l’âge adulte, et que l’antagoniste autoritaire crée des obstacles, même s’il est bien intentionné (comme les parents traditionnels de Jess dans Bend It Like Beckham, qui veulent simplement qu’elle soit heureuse et réussisse selon les normes habituelles de leur culture).

La présence du prédateur peut être plus compliquée. Habituellement, il agira davantage comme un contagoniste, un personnage d’impact apparemment plus sage qui semble offrir à la protagoniste ce qu’elle recherche : un moyen de sortir de son enfance pour entrer dans un nouveau mode d’existence. Mais un véritable prédateur finira par se révéler être un obstacle à l’individuation de la protagoniste. Elle peut se rendre compte que pour s’individualiser par rapport à l’autorité, elle devra peut-être aussi s’individualiser par rapport au prédateur. (Bien que, comme dans le cas de M. Rochester dans Jane Eyre, il soit toujours possible que le prédateur se rachète après avoir pris conscience de son comportement dominateur et qu’il bénisse plutôt la croissance de la protagoniste).

Laquelle de vos forces antagonistes archétypales est le véritable antagoniste de votre histoire dépendra de celle qui sera finalement vaincue au moment culminant. Habituellement, l’antagoniste de la « sous-intrigue » sera vaincu auparavant, mais il est également possible que la véritable confrontation au moment culminant permette une résolution facile du conflit secondaire par la suite.
À moins que l’autorité dans votre histoire ne soit vraiment malveillante (comme le représentent les archétypes de l’ombre plus anciens), il est probable que la transformation de la jeune fille (selon la belle expression de Kim Hudson) « renouvellera le royaume ». Les parents et autres figures d’autorité grandiront eux-mêmes grâce à l’initiation de la jeune fille. Ils la reconnaîtront comme une adulte en devenir et une égale, ils s’écarteront de son chemin et ils béniront probablement sa vie future en lui souhaitant le meilleur.
À bien des égards, l’arc narratif de la jeune fille est le plus relationnel de tous les arcs narratifs, car son antagoniste archétypal est, dans la vie de la plupart des humains, non pas corrompu, mais simplement restrictif. L’autorité ne devient le « méchant » que lorsqu’elle s’oppose égoïstement à une croissance nécessaire. Peut-être plus que toutes les autres forces antagonistes inhérentes, les antagonistes de la jeune fille offrent la possibilité de suivre les arcs de croissance les plus forts qui soient, car la transformation de la jeune fille les incite à suivre leurs propres arcs. En effet, l’arc transformationnel qui suit l’archétype statique du parent est celui de la reine, qui consiste à devenir un véritable leader qui permet et encourage l’indépendance et la responsabilité de ceux dont on a la charge.