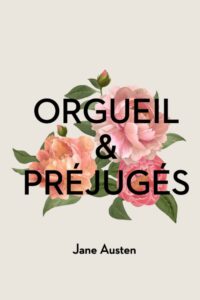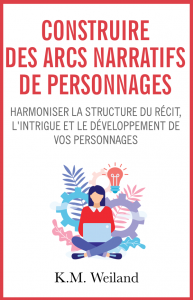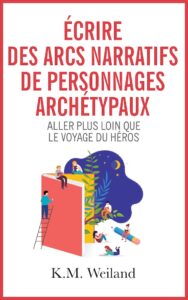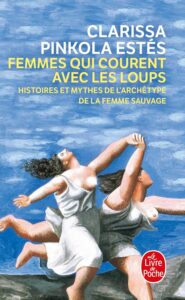La catastrophe est le dénouement à la fin de la scène1. C’est ce que les lecteurs attendent, souvent avec un délicieux sentiment d’appréhension. C’est la réponse, au moins partielle, à cette question cruciale : « Que va-t-il se passer ? »
Le dernier acte de la structure en trois parties de votre scène est le dénouement. Les deux premières parties de la scène(l’objectif et le conflit) posaient une question. Le dénouement y répond. Si le personnage de nos exemples précédents posait la question suivante dans la scène : « Vais-je pouvoir sortir avec le garçon d’à côté ? », la réponse, c’est-à-dire le dénouement, serait soit oui, soit non.
Certains auteurs n’aiment pas l’utilisation du mot « désastre » pour cette dernière partie de la scène, car cela semble indiquer que chaque scène doit se terminer par un cliffhanger à la Périls de Pauline. Cependant, le désastre est un maître du déguisement et peut prendre toutes les formes et toutes les tailles nécessaires pour s’adapter aux besoins de votre histoire et de votre scène spécifiques.
L’important est de garder à l’esprit que les catastrophes font avancer l’intrigue. Si tout se passe à merveille et que les personnages obtiennent exactement les réponses qu’ils espéraient à leurs questions dans la scène, le conflit s’éteint et l’histoire s’essouffle jusqu’à sa fin.
C’est pourquoi je préfère mettre l’accent sur la catastrophe. À la fin de chaque scène, vous devriez chercher un moyen de contrecarrer les espoirs de vos personnages et de rendre leur vie misérable, au moins dans une certaine mesure. Cela ne signifie pas que les personnages ne doivent jamais progresser vers la réalisation de leurs objectifs. Ils peuvent atteindre une partie de leurs objectifs, tout en subissant des revers. L’important est de maintenir la pression et de faire avancer l’intrigue.
Options pour les catastrophes de Scène
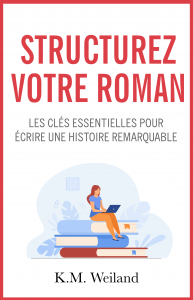
Les catastrophes de Scène sont probablement les éléments de scène les plus faciles à repérer. Si elles causent des difficultés, même momentanées, ce sont des catastrophes.
Les catastrophes peuvent prendre toutes les formes imaginables, mais nous pouvons essayer de les classer dans les catégories de base suivantes :
1. Obstruction directe de l’objectif (par exemple, le personnage veut des informations que l’antagoniste refuse de lui fournir).
2. Obstruction indirecte de l’objectif (par exemple, le personnage est détourné de la réalisation de l’objectif).
3. Obstruction partielle de l’objectif (par exemple, le personnage n’atteint qu’une partie de l’objectif).
4. Victoire creuse (par exemple, le personnage atteint l’objectif, mais se rend compte qu’il est plus destructeur qu’utile).
Ces catastrophes peuvent se manifester de toutes les manières que votre imagination peut concevoir, notamment :
1. La mort.
2. Les blessures physiques.
3. Les blessures émotionnelles.
4. La découverte d’informations compliquées.
5. Les erreurs personnelles.
6. Les menaces à la sécurité personnelle.
7. Les dangers pour autrui.
Rendez votre catastrophe désastreuse
C’est là que la mèche de votre pétard scène s’épuise. Allez-vous offrir à vos lecteurs un feu d’artifice ou un pétard mouillé ? Ne lésinez pas sur les catastrophes. Ce n’est pas le moment de ménager vos personnages. Une catastrophe insignifiante peut laisser les lecteurs insatisfaits. Pire encore, une catastrophe insignifiante vous laisse avec une base fragile pour votre suite et votre scène suivantes. La catastrophe de chaque scène prépare l’objectif de la scène suivante.
Catastrophe insignifiante = scène suivante insignifiante.
L’intensité d’une catastrophe donnée dépendra des désirs et des besoins personnels de votre personnage dans votre intrigue. Un gâteau brûlé peut être sans importance dans un thriller d’espionnage, mais il peut être catastrophique dans une histoire pour jeunes adultes mettant en scène une adolescente qui s’est engagée à préparer un spectaculaire gâteau à trois étages pour la vente de pâtisseries de son école, afin de se faire bien voir par l’équipe des pom-pom girls.
Si votre histoire exige un gâteau brûlé, ne vous contentez pas d’un gâteau légèrement trop cuit. Mais dans le même ordre d’idées, pourquoi se contenter d’un simple gâteau carbonisé ? Pourquoi ne pas envisager les implications d’un incendie de four qui transforme la cuisine en zone de guerre et attire l’attention de toute la ville lorsque les pompiers arrivent en trombe devant la porte d’entrée de l’adolescente ?
Repoussez les limites chaque fois que vous en avez l’occasion. Mais n’oubliez pas de faire preuve de bon sens. Les catastrophes doivent être logiques dans le contexte de l’histoire. Une bombe atomique qui tombe en plein sur la cuisine de l’adolescent est probablement un peu exagérée. Si cela n’a pas de sens dans le contexte de l’histoire, cela ressemblera à du mélodrame.
La catastrophe « Oui, mais… »
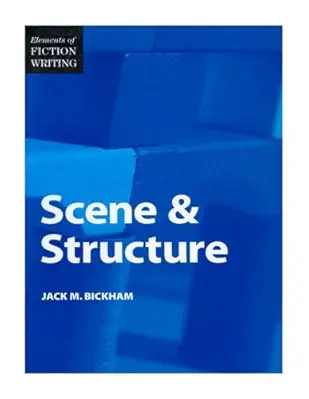
Parfois, pour faire avancer l’intrigue, il vaut mieux laisser vos catastrophes inachevées. Les catastrophes « obstruction partielle de l’objectif » et « victoire creuse » dont nous avons parlé dans la section ci-dessus en sont deux exemples. Dans son livre Scene and Structure, Jack M. Bickham qualifie ces catastrophes partielles de catastrophes « oui, mais… ».
Les catastrophes « oui, mais… » se produisent lorsque vos personnages obtiennent un « oui » conditionnel, voire total, en réponse à la question de la scène. Ils atteignent leurs objectifs de scène… mais il y a des complications imprévues.
Dans le cas d’une obstruction partielle de l’objectif, un personnage peut atteindre une partie de l’objectif de la scène (par exemple, le garçon du voisin accepte de sortir avec elle), mais pas tout ou pas exactement comme prévu (il accepte seulement d’aller prendre un cappuccino rapide au lieu d’un dîner et d’un cinéma).
Dans le désastre de la victoire creuse, les personnages peuvent obtenir exactement ce qu’ils veulent, pour finalement découvrir qu’ils auraient été bien mieux sans. Par exemple, notre adolescente pâtissière peut finir de glacer son magnifique gâteau à trois étages, mais sa mère arrive et lui révèle qu’elle vient d’utiliser le dernier sac de farine et que toute la famille va maintenant mourir de faim (c’est mélodramatique, mais vous voyez l’idée).
Questions à se poser au sujet des catastrophes de votre Scène
Une fois que vous avez identifié la catastrophe de votre scène, posez-vous les questions suivantes :
1. Votre catastrophe répond-elle à la question de la scène, telle que posée par l’objectif de la scène ?
2. Votre catastrophe fait-elle partie intégrante de la scène (par exemple, la catastrophe est-elle le résultat direct du conflit de la scène) ?
3. Votre catastrophe est-elle suffisamment désastreuse ?
4. Si votre personnage atteint partiellement ou totalement l’objectif de la scène, y a-t-il un désastre « oui, mais… » qui attend pour créer un ralentissement ?
5. Votre désastre va-t-il inciter le personnage à se fixer un nouvel objectif ?
Les désastres de scène en action
À quoi ressemblent les désastres de scène réussis ? Examinons les livres et les films que nous avons choisis.
Orgueil et préjugés de Jane Austen : Le premier chapitre se termine par une défaite apparente lorsque M. Bennet refuse la demande de sa femme de rendre visite à M. Bingley. Pour Mme Bennet et les lecteurs, il s’agit d’un désastre total. Elle n’a obtenu rien de ce qu’elle voulait de cette conversation. Ce qu’elle ignore, bien sûr, c’est que M. Bennet fait simplement le difficile, car il a déjà décidé de faire exactement ce qu’elle lui a demandé. Il s’agit en fait d’une variante du désastre « oui, mais… ». Cependant, cette technique doit être utilisée avec prudence, car dans la plupart des cas, elle apparaîtra aux lecteurs comme un mensonge de l’auteur destiné à créer un faux suspense.
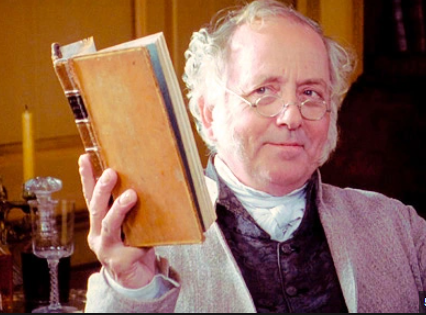
Le dénouement de la première scène dans Pride & Prejudice est habilement discret : M. Bennet contrecarre l’objectif de sa femme en refusant de rencontrer le nouveau voisin, M. Bingley, même s’il avait l’intention de le faire depuis le début. Cela caractérise M. et Mme Bennet (et leur mariage), tout en suscitant l’intérêt pour une scène qui, sans cela, aurait pu être ennuyeusement simple.
La vie est belle réalisé par Frank Capra : La scène d’ouverture avec les anges ne se termine véritablement qu’au début du troisième acte, lorsque Clarence apparaît à Bedford Falls pour sauver George, et même là, cela n’est que suggéré. Techniquement, tout le film jusqu’à ce moment-là fait partie de cette première scène, puisqu’il s’agit simplement d’une dramatisation de Joseph résumant la vie de George à Clarence. Le désastre de la scène serait donc la fin de l’histoire de Joseph, dans laquelle George décide de se suicider pour toucher les 15 000 dollars de son assurance-vie.

La vie est belle offre un exemple intéressant de résultat d’une scène qui est montré bien plus tard que les deux éléments précédents de la scène (objectif et conflit). (It’s a Wonderful Life (1947), Liberty Films.)
La Stratégie Ender d’Orson Scott Card : Le premier chapitre se termine par un désastre spectaculaire, dans lequel le conflit avec les brutes oblige Ender à prendre des mesures brutales. Il bat si violemment le chef des brutes, Stilson, qu’il est sous-entendu (et confirmé plus tard) que le garçon meurt. Bien qu’Ender atteigne son objectif immédiat, qui est d’échapper aux brutes, il sera hanté par la mort de Stilson pendant le reste de l’histoire.

Le dénouement de la première scène d’Ender’s Game est captivant par sa brutalité inattendue et plante parfaitement le décor pour les personnages, l’intrigue et le thème. (Ender’s Game (2013), Lionsgate.)
Master and Commander : De l’autre côté du monde réalisé par Peter Weir : Après un conflit discret au cours duquel l’aspirant Hollom se demande s’il doit ou non sonner l’alarme et appeler le capitaine sur le pont, le désastre frappe de manière dramatique lorsque le corsaire françaisAcheron ouvre le feu sur le Surprise depuis le brouillard. S’ensuit une bataille tendue et sanglante qui détruit le navire.

Après un objectif et un conflit d’ouverture relativement discrets, Master and Commander : De l’autre côté du monde se termine par une scène qui (littéralement) fait tout exploser. (Master and Commander : De l’autre côté du monde (2003), Miramax Films.)
Une fois que vous avez créé un désastre solide qui découle naturellement de l’objectif et du conflit de votre scène, vous aurez créé la première de nombreuses scènes solides. Empilés les uns sur les autres, ces éléments constitutifs en trois parties créeront votre histoire.
- Dans le cadre de cette série, le terme « Scène » avec un S majuscule désignera la scène en général (qui peut inclure dans sa définition la suite). J’utiliserai un s minuscule et mettrai en italique les termes scène et suite pour désigner les deux types de scènes différents. ↩︎