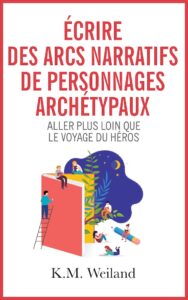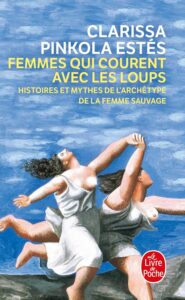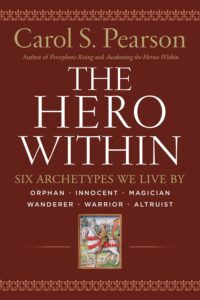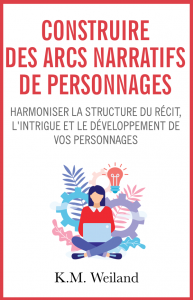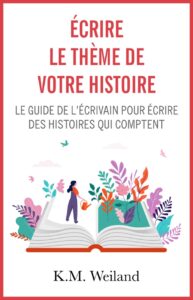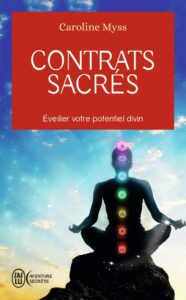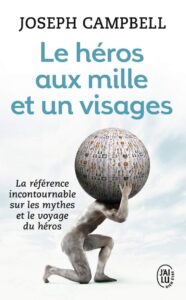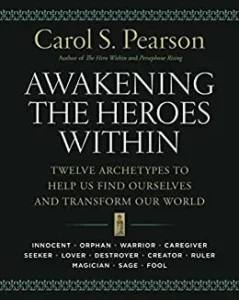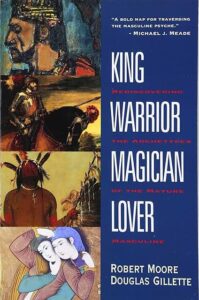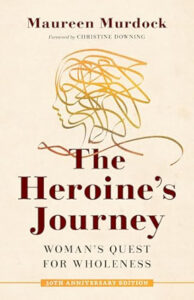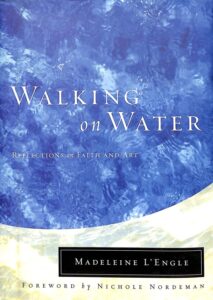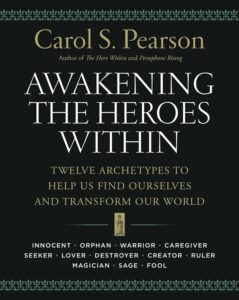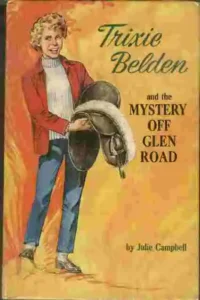Les antagonistes sont un sujet intéressant pour tout écrivain. Souvent, lorsque nous concevons ou élaborons l’intrigue d’une histoire, l’antagoniste peut être une réflexion après coup, en particulier dans les fictions de genre ou « axées sur l’intrigue », dans lesquelles l’antagoniste est moins susceptible d’avoir une relation avec le protagoniste et plus susceptible d’être une sorte de « grand méchant ».
Mais à bien des égards, l’antagoniste est l’élément central de tout type d’histoire. C’est grâce à lui qu’il y a une histoire. Sans antagoniste, sans quelque chose qui s’oppose à la progression du protagoniste ou qui le pousse à évoluer en raison de la nécessité de faire évoluer ses paradigmes personnels et sociaux, il n’y a pas vraiment d’histoire, n’est-ce pas ? À tout le moins, il n’y a pas vraiment de transformation.
Il est donc tout aussi intéressant d’examiner les antagonistes archétypaux que les protagonistes archétypaux.
Au début de l’année, j’ai publié une longue série d’articles sur les arcs narratifs archétypaux. Cette série traitait de certains archétypes de changement positif, de régression ou de stagnation négative, et d’archétypes « au repos » ou plats qui ponctuent les grands cycles de transformation de la vie humaine.
Beaucoup de ces archétypes interagissent entre eux en tant qu’antagonistes les uns des autres. En particulier, les archétypes négatifs de l’ombre peuvent souvent être considérés comme les antagonistes intérieurs et extérieurs que les archétypes positifs (tels que le héros ou la reine) doivent surmonter afin de compléter leur propre arc narratif. Dans cette série, j’ai également reconnu et mentionné, sans toutefois les aborder en profondeur, certains antagonistes archétypaux plus abstraits et qui ne sont pas toujours caractérisés comme des antagonistes humains spécifiques au même titre que les « archétypes négatifs ». Au début de la publication de cette série, l’un d’entre vous m’a demandé d’explorer plus en profondeur ces forces antagonistes archétypales, une demande pour laquelle je suis très reconnaissant, car elle m’a incité à approfondir mon exploration et ma réflexion sur ce sujet intemporel des personnages et des arcs archétypaux.
Écrire des arcs de personnages archétypaux (lien affilié)
Aujourd’hui, je vais donc lancer une série relativement courte (seulement [!] sept parties) consacrée aux antagonistes archétypaux inhérents à chacun des six principaux « arcs de vie » archétypaux. Voici un rappel général de chacun de ces arcs, ainsi que des antagonistes archétypaux associés dont nous discuterons dans cette nouvelle série :
1. L’arc de la jeune fille
Antagonistes archétypaux : l’autorité et le prédateur
2. L’arc du héros
Antagonistes archétypaux : le dragon et le roi malade
3. L’arc de la reine
Antagonistes archétypaux : l’envahisseur et le trône vide
4. L’arc du roi
Antagonistes archétypaux : le cataclysme et le rebelle
5. L’arc de la vieille femme
Antagonistes archétypaux : la mort, la peste et le tentateur
6. L’arc du magicien
Antagonistes archétypaux : le mal et la faiblesse de l’humanité
Dans les prochains articles, nous examinerons chacun de ces éléments plus en détail en relation avec les arcs spécifiques. Pour aujourd’hui, je voudrais commencer par un aperçu rapide de ce que ces antagonistes archétypaux représentent globalement tout au long des arcs.
Quelle est la différence entre un antagoniste et une force antagoniste ?
L’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas approfondi les antagonistes archétypaux dans la série originale est que les antagonistes thématiques généraux de chaque arc ou parcours sont clairement des forces abstraites : le dragon, le cataclysme, la mort, le mal, etc. Bien qu’ils puissent être personnifiés ou anthropomorphisés dans certains types d’histoires (par exemple, Smaug dans Le Hobbit ou la mort dans « Le conte des trois frères » de Harry Potter), dans toute histoire « réaliste », ces forces seront symboliquement représentées soit par un simple humain, soit par un système humain, soit simplement par une abstraction qui n’est même pas nommée au-delà de la lutte intérieure du protagoniste (par exemple, le « Mal » auquel est confronté le personnage de Mage joué par Will Smith dans La Légende de Bagger Vance n’est « que » la perte de sens et de but d’un homme après avoir souffert pendant la Première Guerre mondiale).

La Légende de Bagger Vance (2000), DreamWorks Pictures.
Et c’est là qu’il devient important de faire la distinction entre un « antagoniste » et une « force antagoniste ». Pour définir simplement, l’antagoniste dans une histoire est toute personne ou toute chose qui crée systématiquement des obstacles entre le protagoniste et son objectif ultime dans l’intrigue. Bien que les antagonistes archétypaux dont nous parlerons dans cette série soient reconnus comme représentant une sorte de corruption morale, le mot « antagoniste » en soi n’indique jamais aucun type d’alignement moral. Il est possible que l’antagoniste soit la personne la plus morale de l’histoire et le protagoniste la moins morale, ce qui est souvent le cas dans les histoires avec un protagoniste à l’arc de changement négatif.
Par conséquent, l’antagoniste n’a pas besoin d’être humain ni même spécifiquement conscient. En général, le terme « antagoniste » peut être utilisé pour désigner un antagoniste humain (ou humanisé), tandis que le terme plus large « force antagoniste » peut être utilisé pour désigner une forme plus abstraite d’obstacle à la progression du protagoniste.
De plus, il est à la fois possible et courant de voir un antagoniste humain spécifique « représenter » une force antagoniste plus grande et plus abstraite. Par exemple, dans Le Seigneur des anneaux, le sorcier Saroumane est à la fois le représentant direct (parfois) de la force antagoniste supérieure de Sauron (une représentation à peine anthropomorphisée du Mal) et un antagoniste humain contre lequel les protagonistes doivent lutter.

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003), New Line Cinema.
Les « forces » antagonistes, plus encore que les antagonistes, ont tendance à être profondément thématiques. Elles peuvent même n’être rien de plus dans l’histoire qu’une représentation du mensonge auquel croit le protagoniste — et que celui-ci doit surmonter afin de poursuivre son cheminement vers la maturité. Même si un protagoniste doit finalement vaincre physiquement un antagoniste humain, cette bataille finale n’est en réalité qu’une représentation (une métaphore extériorisée) de la défaite de l’antagoniste thématique plus important. Il est donc souvent utile, voire souhaitable, de créer une histoire qui offre à la fois une force antagoniste et un antagoniste spécifique pour représenter cette force abstraite dans le conflit réel de l’intrigue.
Antagonistes intérieurs et extérieurs
Lorsque j’ai commencé à réfléchir à l’élargissement des antagonistes archétypaux, j’ai réalisé que les six principaux arcs de vie de changement positif offraient tous des exemples intrinsèquement archétypaux à la fois de la force antagoniste thématique (par exemple, le cataclysme du roi) et d’un antagoniste plus pratique basé sur l’intrigue et représenté par un ou plusieurs autres personnages (par exemple, les rebelles du roi).
Que vous choisissiez ou non de les caractériser séparément, ils vous offrent la possibilité d’examiner plus en profondeur les conflits intérieurs et extérieurs de votre protagoniste, et la manière dont vous pouvez les réunir avec cohésion et résonance. Comme vous l’avez peut-être remarqué dans ma liste d’antagonistes archétypaux ci-dessus, j’en ai ajouté quelques-uns qui n’étaient pas directement spécifiés comme tels dans la série originale. En effet, j’ai accordé une importance égale aux deux types d’antagonistes pour chaque arc archétypal.
Cependant, le choix de l’antagoniste représenté dans le conflit extérieur et celui principalement concerné par le conflit intérieur dépendra de la manière dont vous choisissez de dramatiser le thème de votre histoire. Par exemple, dans un arc de la jeune fille, son conflit intérieur peut se concentrer sur son propre sentiment intériorisé d’autorité, tandis que le prédateur est extériorisé (comme dans Jane Eyre). Il serait toutefois tout aussi valable de présenter un prédateur dévalorisant et dévorant comme sa propre critique intérieure, tandis qu’elle est confrontée à une autorité abusive ou restrictive dans l’intrigue externe (comme dans Little Dorrit).

Little Dorrit (2008), BBC / WGBH Boston.
En réalité, ce sont les deux faces d’une même médaille : l’une représente l’autre, mais au final, elles représentent toutes deux le même combat thématique. L’importance accordée à l’une plutôt qu’à l’autre dépend souvent du caractère plus interne et relationnel ou plus externe et axé sur l’action de l’histoire elle-même. Quoi qu’il en soit, votre protagoniste finira par affronter les deux, sous une forme ou une autre. Si l’antagoniste externe doit être vaincu, c’est généralement parce que le protagoniste a déjà vaincu l’antagoniste interne. Ou, si le conflit interne n’est pas vraiment abordé dans l’histoire, la destruction de l’antagoniste externe peut être considérée comme une métaphore du triomphe interne du personnage sur la force antagoniste supérieure.
Antagonistes et contagonistes
Dans le système Dramatica de théorie narrative, Chris Huntley et Melanie Anne Phillips ont inventé le terme « contagoniste » pour désigner une force opposée dans l’histoire qui n’était pas aussi directement opposée au protagoniste que l’antagoniste proprement dit. Bien que le contagoniste puisse parfois être un représentant direct de l’antagoniste ou ce que John Truby appelle un « faux allié », il peut tout aussi bien s’agir d’un personnage qui, au moins au niveau de l’intrigue (sinon au niveau thématique), est totalement séparé de la force antagoniste principale.
Le contagoniste est une sorte d’« antagoniste secondaire », qui peut être plus proche du protagoniste que le véritable antagoniste « Big Bad » et qui a donc plus d’influence sur le conflit interne du protagoniste. Le système Dramatica oppose les contagonistes au mentor (dans un rôle de personnage secondaire). Ensemble, ils agissent comme le « diable » et « l’ange » rivaux sur les épaules du protagoniste, chacun cherchant à être le personnage d’impact qui influence les choix thématiques du protagoniste et détermine si celui-ci restera dans le mensonge ou évoluera vers la vérité.
Bien que les paires d’archétypes antagonistes dont nous allons parler ne correspondent pas toujours parfaitement aux rôles d’antagoniste/contagoniste, il est utile de garder cette dynamique à l’esprit comme une autre façon d’examiner la force antagoniste thématique plus grande et plus abstraite et les antagonistes humains plus proches et plus intimes qui peuplent votre histoire.
Une fois encore, Saroumane dans Le Seigneur des anneaux en est un bon exemple, dans la mesure où il incarne un antagoniste humain spécifique qui peut être considéré comme remplissant ce rôle à travers différents archétypes, selon les personnages qui s’opposent à lui : héros, reines, vieilles femmes, mages, etc. Par exemple, il peut être vu tour à tour comme le roi malade dont le royaume est en train de mourir à cause de sa négligence et que le « héros » Frodon doit guérir, le tyran que la « reine » Aragorn doit remplacer, et le tentateur auquel la « vieille femme » Gandalf le Gris doit résister.

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001), New Line Cinema.
Saroumane est le représentant de la force antagoniste globale représentée par Sauron, mais il agit également pour son propre compte, parfois même (secrètement) en opposition à Sauron. Sa présence dans l’histoire permet aux personnages d’affronter différentes facettes et incarnations de la force antagoniste thématique globale, ce qui n’aurait pas été possible s’ils avaient simplement affronté le grand méchant Sauron.
***
À bien des égards, comprendre l’antagoniste et/ou la force antagoniste de votre histoire est la clé non seulement de l’intrigue, mais aussi de la compréhension de la véritable signification thématique de votre histoire, qu’elle suive spécifiquement une intrigue archétypale ou non.
Retrouvez tous les articles sur les différents archétypes et les arcs de transformation des personnages sur Archétypes et arcs narratifs