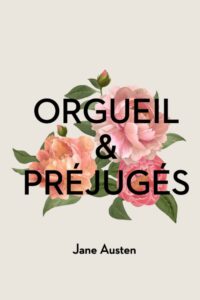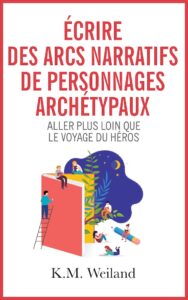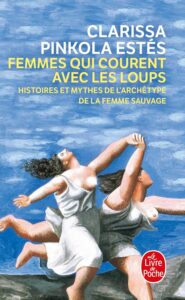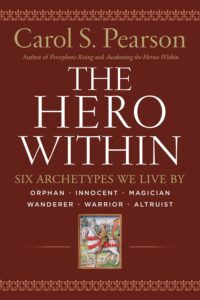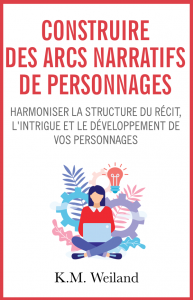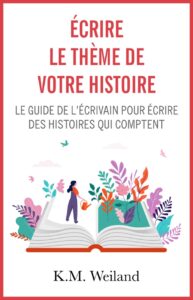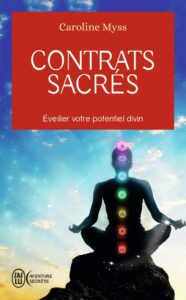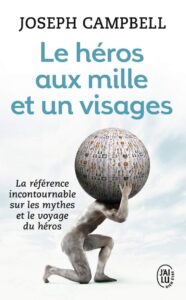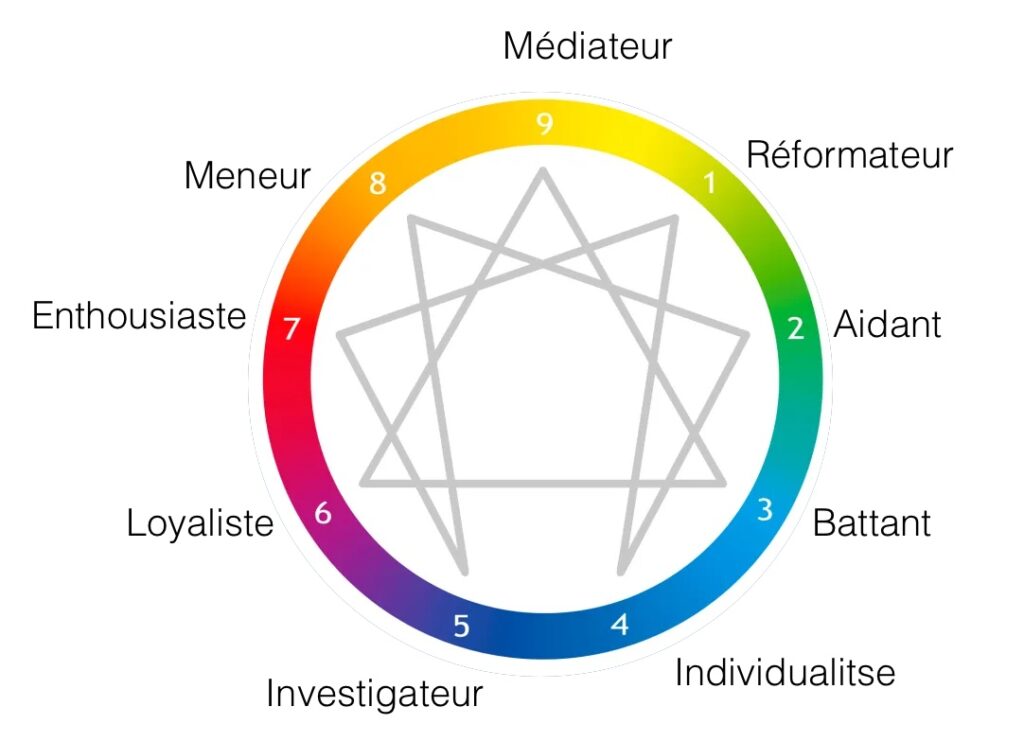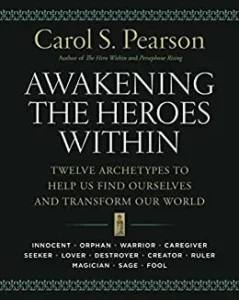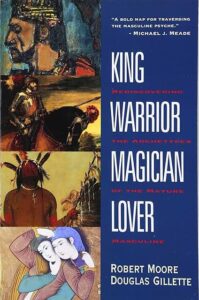Dans un roman comme dans un film, l’histoire dans son ensemble et chaque scène1 qui la compose commencent par un objectif. Vos personnages veulent quelque chose, quelque chose qu’ils auront du mal à accomplir. Ce qu’ils veulent définit l’intrigue à la fois au niveau macro et micro. Ce qu’ils veulent les définit et, par extension, définit le thème du livre.
Les possibilités d’objectifs pour une scène sont infinies et très spécifiques à votre histoire. Vos personnages peuvent vouloir n’importe quoi dans n’importe quelle scène, mais parmi toutes les options possibles, vous devez réduire les désirs exprimés dans une scène donnée à ceux qui feront avancer l’intrigue. Vouloir acheter des œillets roses pour la fête des mères est un objectif louable, mais si la mère de votre personnage est un personnage inexistant dans votre histoire de guerre nucléaire, cela n’aura pas sa place dans votre histoire, et certainement pas en tant qu’objectif de scène.
Les objectifs de scène sont les dominos dont je parle toujours. Chaque objectif est un pas en avant dans votre histoire. Un objectif mène à un résultat qui donne lieu à un nouvel objectif, et ainsi de suite. Bing-bing-bing — ils se font tomber les uns les autres, un domino après l’autre. Si ce n’est pas le cas — si un objectif n’a pas sa place dans l’histoire globale — la ligne de dominos s’arrêtera et l’histoire vacillera, peut-être de manière fatale.
Objectifs de l’intrigue vs objectifs de Scène
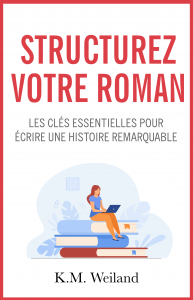
L’objectif global de l’intrigue de votre protagoniste sera un problème qui nécessitera toute l’histoire pour être résolu. Elle peut vouloir devenir présidente, elle peut vouloir sauver sa fille kidnappée, elle peut vouloir épouser le garçon d’à côté, ou elle peut vouloir trouver la guérison et un nouveau départ après la mort de son père. Si nous décomposons cet objectif global, qui s’étend sur toute l’histoire, en petits morceaux, nous constatons qu’il est en réalité constitué d’une succession de petits objectifs.
Votre personnage ne sait peut-être même pas au départ qu’il veut prendre un nouveau départ ou épouser le garçon d’à côté (même si cela devrait être immédiatement évident pour les lecteurs, ne serait-ce que par implication). Mais dès la toute première scène, il sait qu’il veut quelque chose.
Peut-être veut-il que le chien du voisin cesse de mâcher ses pétunias. Il sait alors qu’il doit rencontrer le voisin et le convaincre d’attacher son chien. Puis elle se rend compte qu’il est incroyablement mignon. Elle sait alors qu’elle veut sortir avec lui. Elle sait alors qu’elle doit surmonter sa mauvaise première impression. Elle sait alors qu’elle doit apporter une offrande de paix. Etc., etc., etc.
Avant même de vous en rendre compte, tous ces petits objectifs de scène vous mèneront directement à l’objectif global de l’histoire.
Le facteur le plus important à garder à l’esprit lorsque vous identifiez chaque objectif de scène est sa pertinence par rapport à l’intrigue. Les intrigues secondaires peuvent offrir des opportunités pour des objectifs qui ne sont pas directement liés à votre objectif principal, qui est d’épouser le garçon d’à côté, mais elles doivent elles aussi finir par s’intégrer à l’intrigue globale d’une manière percutante ou thématiquement résonnante. Si la réalisation ou l’échec d’un objectif donné d’unescène n’affecte pas le résultat global de l’histoire, il n’est probablement pas assez pertinent.
Options pour les objectifs de Scène
Les objectifs de Scène peuvent se manifester de manière très différente. Votre personnage peut vouloir brûler un paquet de lettres, faire une sieste, se cacher dans un placard ou couler un bateau. Mais la plupart des objectifs de scène se résument à l’une des catégories suivantes.
Votre personnage va vouloir :
1. Quelque chose de concret (un objet, une personne, etc.).
2. Quelque chose d’immatériel (de l’admiration, des informations, etc.).
3. Échapper à quelque chose de physique (l’emprisonnement, la douleur, etc.).
4. Échapper à quelque chose de mental (l’inquiétude, la suspicion, la peur, etc.).
5. Échapper à quelque chose d’émotionnel (le chagrin, la dépression, etc.).
Les méthodes utilisées par votre personnage pour atteindre ces objectifs se manifesteront souvent de l’une des manières suivantes (bien que cette liste ne soit certainement pas exhaustive) :
1. Rechercher des informations.
2. Cacher des informations.
3. Se cacher soi-même.
4. Cacher quelqu’un d’autre.
5. Affronter ou attaquer quelqu’un d’autre.
6. Réparer ou détruire des objets physiques.
Objectifs partiels et généraux
Bien que les objectifs d’une scène soient toujours à court terme (par opposition à l’objectif à long terme de l’intrigue), ils ne se limitent pas toujours à une seule scène et ne sont pas toujours atteints dans une seule scène. Parfois, votre histoire exigera des objectifs généraux qui s’étendent sur plusieurs scènes. Par exemple, votre personnage peut savoir dans la scène n° 3 qu’il veut sortir avec le garçon d’à côté, mais ce n’est pas un objectif qu’il peut atteindre en une seule scène. Elle ne parviendra peut-être à atteindre cet objectif particulier qu’à la scène n° 11.
C’est là que les objectifs partiels entrent en jeu. Tout comme les objectifs de scène contribuent à l’objectif global de l’histoire, les objectifs partiels contribuent à la réalisation des objectifs généraux au sein d’une séquence de scènes, qui elles-mêmes mènent finalement à l’objectif global. Dans notre exemple, le parcours du personnage pour atteindre cet objectif global particulier peut inclure des objectifs partiels tels que croiser délibérément le garçon voisin à plusieurs reprises, obtenir son numéro de téléphone et s’excuser d’avoir crié sur son chien.
Les objectifs globaux qui nécessitent plusieurs scènes pour être atteints ne suppriment pas la nécessité d’avoir des objectifs individuels dans chaque scène intermédiaire. Mais ne vous limitez pas à l’idée que chaque scène doit être une île en soi. Chaque scène n’est qu’une petite partie d’un tout plus grand. Comme tout doit être intégral, tout ne peut qu’être intimement lié.
Questions à se poser au sujet des objectifs de votre scène
Une fois que vous avez identifié l’objectif de votre scène, arrêtez-vous et posez-vous les questions suivantes :
1. L’objectif a-t-il un sens dans l’intrigue globale ?
2. L’objectif est-il inhérent à l’intrigue globale ?
3. La complication/résolution de l’objectif mènera-t-elle à un nouvel objectif/conflit/désastre ?
4. Si l’objectif est mental ou émotionnel (par exemple, être heureux aujourd’hui), a-t-il une manifestation physique (par exemple, sourire à tout le monde) ? (Ce n’est pas toujours nécessaire, mais permettre aux personnages de montrer ouvertement leurs objectifs offre une présentation plus forte que le simple fait de raconter, via un récit interne).
5. La réussite ou l’échec de l’objectif a-t-il une incidence directe sur le narrateur de la scène ? (Si ce n’est pas le cas, le point de vue de ce personnage n’est probablement pas le bon choix.)
Exemples d’objectifs de scène
Examinons quelques objectifs de scène en pratique.
Orgueil et préjugés de Jane Austen : l’objectif de Mme Bennet dans le premier chapitre est de convaincre son mari de rendre visite à M. Bingley, qui vient d’arriver. Même si elle n’est pas le personnage principal de l’histoire, elle est l’actrice principale de cette première scène, il est donc approprié que le premier objectif lui appartienne. Le chapitre offre un merveilleux objectif d’ouverture, car il présente non seulement un objectif scénique à court terme, mais il encadre également parfaitement l’objectif global de l’histoire.
La vie est belle réalisé par Frank Capra : l’objectif de l’ange Joseph dans la première scène est de trouver un ange qu’il pourra envoyer aider George Bailey. Comme Orgueil et préjugés, le film s’ouvre d’un point de vue extérieur à celui du protagoniste, mais il présente une image instantanée et précise de l’objectif global de l’histoire (à savoir sauver George Bailey en l’aidant à comprendre que sa vie vaut la peine d’être vécue).
La stratégie Ender d’Orson Scott Card : Le livre s’ouvre sur plusieurs courtes scènes indiquant les objectifs des personnages autres que le protagoniste (utilisées, une fois encore, pour définir l’orientation générale de l’intrigue). Le premier objectif d’Ender est d’éviter les brutes et de monter dans le bus scolaire sans incident.
Master and Commander : de l’autre côté du monde réalisé par Peter Weir : L’objectif global de l’histoire et, par extension, le premier objectif individuel de la scène sont présentés dans le plan d’ouverture du film avec la révélation des ordres de Jack Aubrey de trouver et de détruire le corsaire français Acheron. Le film établit rapidement cet objectif en permettant aux spectateurs de lire directement les ordres, puis passe à la première scène où l’officier de quart scrute la mer à la recherche de toute anomalie qui pourrait s’avérer être leur proie.
Une fois que vous avez défini un objectif approprié, le reste de votre scène devrait se dérouler facilement et de manière organique. Tant que chaque scène fait partie intégrante de votre histoire et fait avancer l’intrigue, vous serez sur la bonne voie pour obtenir un roman solide et cohérent.
- Dans le cadre de cette série, le terme « Scène » avec un S majuscule désignera la scène en général (qui peut inclure dans sa définition la suite). J’utiliserai un s minuscule et mettrai en italique les termes scène et suite pour désigner les deux types de scènes différents. ↩︎